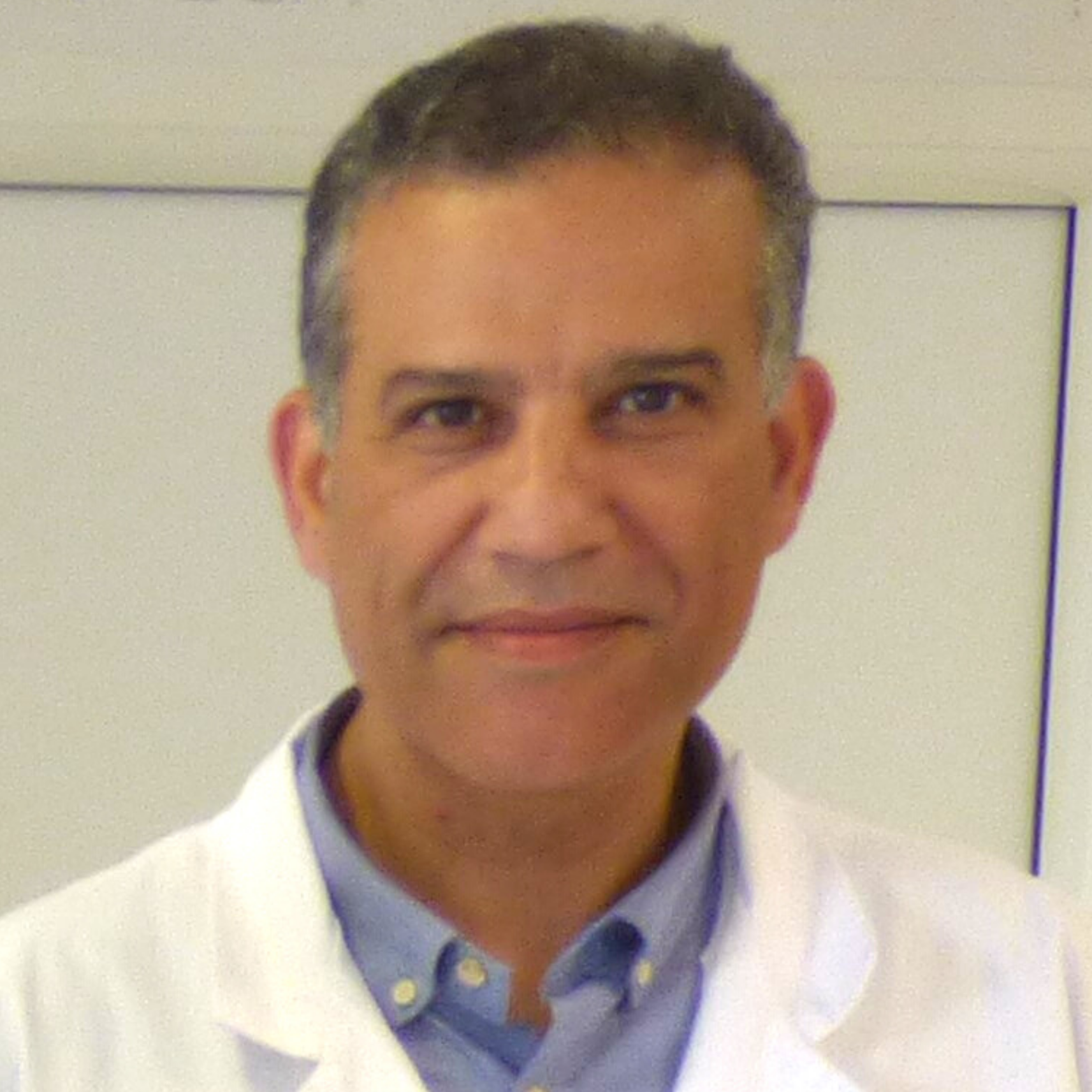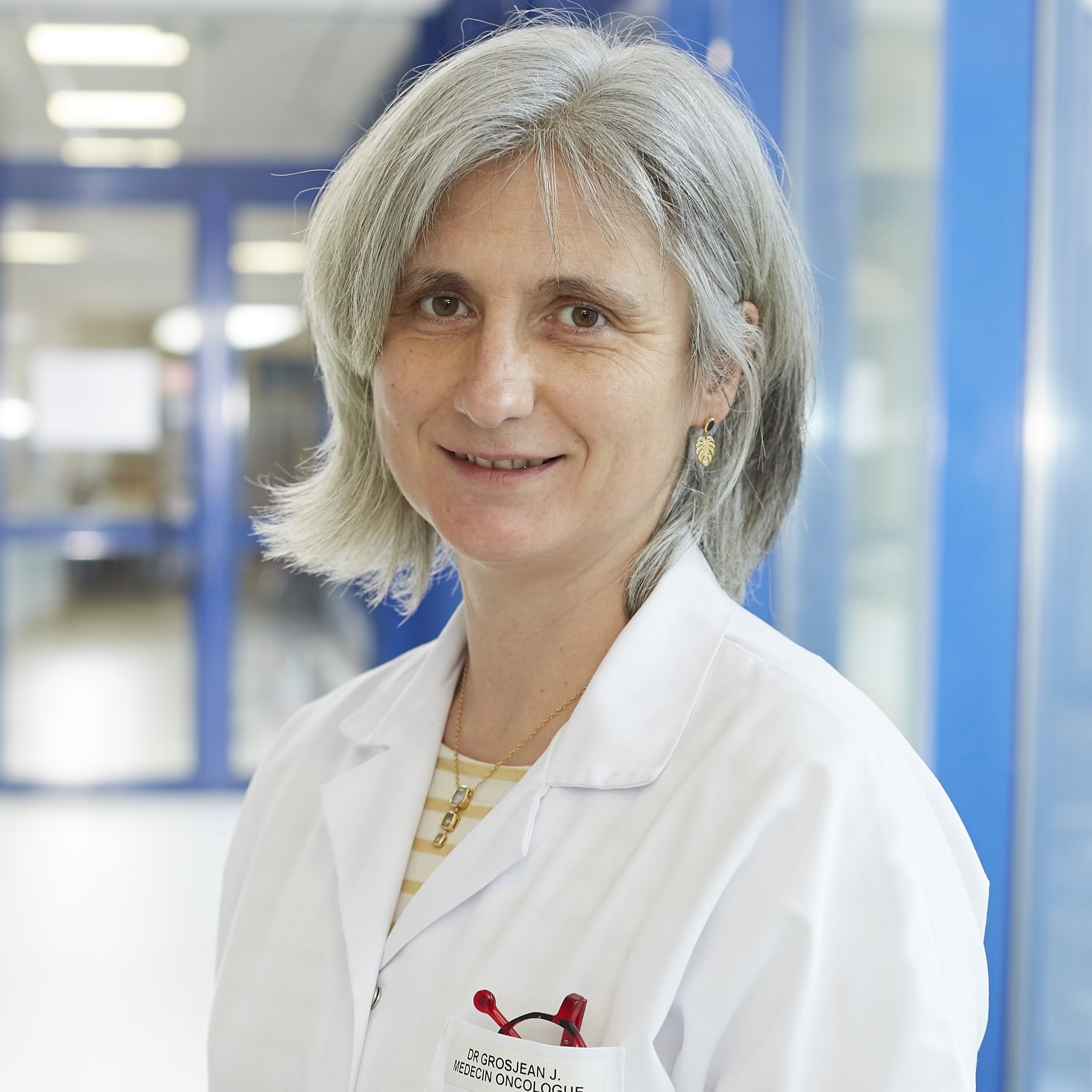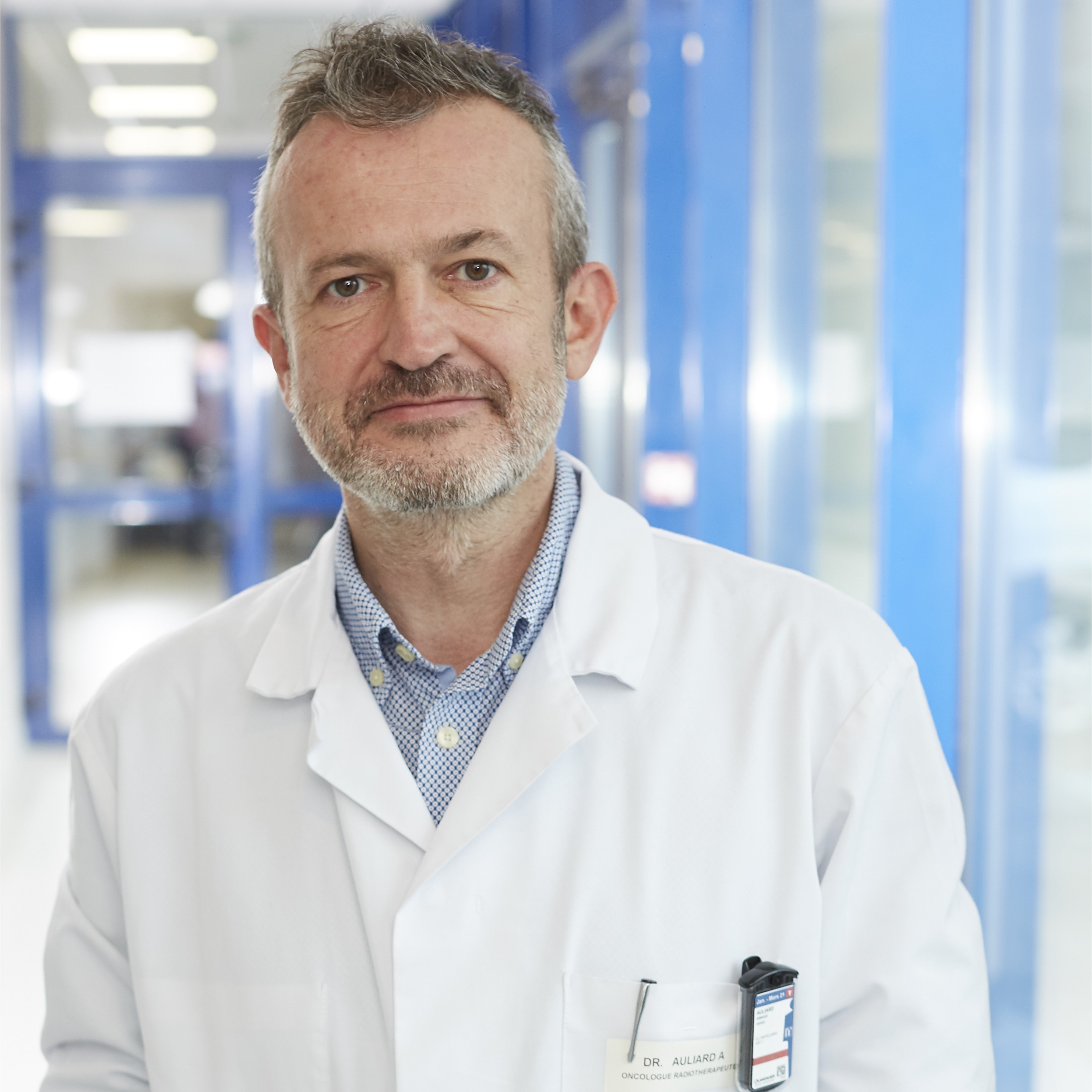Cancer du rein

Les symptômes cliniques d’un cancer du rein sont devenus aujourd’hui très rares, car la très grande majorité des tumeurs rénales jusqu'à 70% sont découvertes fortuitement.
Toutefois, la présence de sang dans les urines ou la survenue d’une douleur rénale ou d'une fièvre inexpliquée a pu vous alerter. Aucun de ces signes n'est cependant spécifique.
Dans d’autres circonstances, la fatigue, la perte de poids ou l’élévation des globules rouges, lors d’un examen, sont considérées comme des signaux d’alarme. La découverte d’une tumeur solide du rein même de moins de 2cm peut évoquer un cancer..
Diagnostic
Le diagnostic est fait dans 70% des cas de façon fortuite et dans 30% des cas à l’occasion d’un symptôme (douleurs, sang dans les urines, fatigue…). Il s’agit également d’une pathologie plus fréquente chez les patients en insuffisance rénale chronique.
Le bilan fait appel à l’imagerie par scanner et/ou IRM afin d’évaluer le degré d’extension de la tumeur.
Traitement
Avant toute chirurgie, on s’assure du bon fonctionnement de l’autre rein et on vérifie, en cas de doute, l’extension veineuse en pratiquant un doppler ou une IRM. Cette extension peut modifier la tactique chirurgicale et éventuellement rendre souhaitable l’intervention d’un chirurgien cardio-vasculaire.
Le traitement est chirurgical dans la très grande majorité des cas. Différents critères vont rentrer en ligne de compte pour décider du traitement le plus adapté comme, entre autres, la taille.
-Pour les tumeurs de plus de 7 cm l'intervention la plus classique est la néphrectomie élargie qui repose sur l’ablation de la totalité du rein. Elle peut se compléter d’une surrénalectomie selon la localisation de la tumeur rénale.
-Pour les tumeurs de moins de 4 cm, une néphrectomie partielle doit être envisagée ce qui permet de conserver une partie du rein. Elle n'est cependant pas toujours techniquement réalisable.
-Entre 4 et 7 cm, l'urologue décidera la meilleure stratégie entre néphrectomie élargie ou partielle.
L'opération peut se faire par voie ouverte ou par coelioscopie, c'est-à-dire que le chirurgien conduit l'intervention sous caméra en introduisant des instruments à l'intérieur du patient à travers la paroi abdominale par de petites incisions.
Lorsqu’elle n’est pas possible, une chirurgie classique par lombotomie ou laparotomie est proposée. Dans certaines situations, une chirurgie lourde peut être réalisée en collaboration avec les chirurgiens cardio-vasculaires. Le traitement conservateur par radiofréquence est également une des options de traitement.
Le tiers d’un rein suffit à assurer l’autonomie sur le plan de la fonction rénale. L’extension métastatique impose en complément le recours à un traitement complémentaire le plus souvent par des médicaments appelés anti-angiogéniques.
Suivi
Le suivi s’étale sur 5 à 10 ans en raison de récidives possibles à distance dont la fréquence est variable en fonction du stade initial de la maladie. Il comporte une créatininémie et une tomodensitométrie (TDM) thoraco abdominale répétées chaque année pour les formes de bon pronostic, deux fois par an pour les autres formes.
Parmi les tumeurs du rein, on distingue les tumeurs bénignes, essentiellement kystiques des tumeurs malignes, habituellement solides et cancéreuses.
Les kystes du rein sont très fréquents et cette fréquence augmente avec l’âge. L’absence de gravité de cette lésion ne justifie pas de traitement, ni de surveillance spécifique.
Les tumeurs solides, sont évaluées à environ 5 000 nouveaux cas par an en France. Le cancer à cellules claires représente 70 % des différentes formes de tumeurs rénales. Les tumeurs rénales cancéreuses entraînent environ 2500 décès par an en France.
Diagnostic
C’est par un examen radiographique abdominal (échographie, scanner) que sont découvertes la majorité des tumeurs rénales. L’absence de symptômes permet de découvrir des tumeurs de petite taille, le plus souvent dans le cadre d’examens demandés dans un contexte extérieur au rein (surveillance digestive, douleurs abdominales atypiques)
Les symptômes des tumeurs du rein apparaissent en cas de volume tumoral important : hématurie totale, douleur lombaire, pesanteur lombaire. Très rarement, des métastases (pulmonaires, hépatiques ou osseuses) sont inaugurales.
Examens complémentaires
Les examens complémentaires permettent un diagnostic précis et complet de la tumeur rénale.
ECHOGRAPHIE ABDOMINALE : Elle permet le plus souvent de faire la découverte et le diagnostic de ces lésions rénales. On retrouve alors une déformation de contours du rein ou de sa structure interne. L’analyse de la tumeur porte sur sa taille, sa structure (liquidienne, solide ou mixte) et ses rapports avec le rein normal.
SCANNER ABDOMINAL ET THORACIQUE : Il confirme le diagnostic échographique et affine l’analyse de la structure tumorale et de ses rapports avec le rein. Il permet en plus de préciser la présence ou l’absence de lésions métastatiques (ganglion, poumon) en cas de tumeur maligne.
IRM : apporte des renseignements intéressants dans le cadre de tumeurs atypiques, puisqu’elle apporte des données structurelles supplémentaires. En cas de tumeur envahissant les éléments vasculaires veineux, elle montre le niveau supérieur de l’envahissement et les possibilités chirurgicales qui en découlent.
D'autres examens radiographiques sont utiles dans des cas particuliers. (artériographie, angiographie)
BIOPSIE : de la tumeur rénale, reste la solution utilisée en cas de tumeurs difficiles à classifier ou dans le cas de tumeurs de petite taille. Elle se pratique sous contrôle échographique scannographique en fonction de l’accessibilité de la tumeur.
Traitement
Aucun traitement n’est nécessaire en cas de kyste rénal. Une surveillance peut être proposée en cas de kyste de volume important ou d’aspect atypique.
En cas de tumeur rénale solide, du fait du risque cancéreux important, l’ablation chirurgicale est indispensable. Cette ablation peut être limitée à la tumeur : (tumorectomie ou néphrectomie partielle) ou totale (néphrectomie élargie). Le choix d’une chirurgie conservatrice est toujours préféré quand les conditions d’exérèse chirurgicale le permettent.
La chirurgie rénale s’effectue par voie coelioscopique, ou par abord chirurgical. Elle nécessite le contrôle premier des vaisseaux rénaux puis l’ablation réglée de la tumeur ou du rein dans sa totalité. Le temps d’hospitalisation varie de 5 à 8 jours.
En cas de tumeur rénale métastatique, de nouveaux traitements chimiothérapiques (traitement antiangiogénique qui bloque le développement des vaisseaux de la tumeur) apportent des espoirs de contrôle de la maladie.
Cancer de la Prostate

Symptômes
Le cancer de la prostate évolue à bas bruit sans donner de signes urinaires à ses débuts.
La survenue plus tardive de troubles urinaires peut être la conséquence d’une compression qui s’exerce sur l’urètre et la vessie du fait de la présence d’une tumeur. Mais ces signes peuvent prêter à confusion car, à cet âge, ils sont souvent liés à un adénome prostatique associé.
Diagnostic et dépistage
Le cancer peut être diagnostiqué lors du dépistage recommandé par l’AFU à tout homme à partir de 50 ans. Ce dépistage comprend un dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) et un toucher rectal. Il peut aussi être mis en évidence chez un patient suivi pour un adénome de la prostate ou se révéler d’emblée à un stade avancé par des douleurs abdominales ou osseuses. Stades :
-Sont à faible risque les tumeurs T1a et T2a avec PSA 20 et score de Gleason > 8, et les T3a et b
-Sont à risque intermédiaire les tumeurs T2b avec PSA entre 10 et 20 et Gleason à 7
Le dépistage du cancer de la prostate doit être réalisé après information du patient. Le débat autour du dépistage ne doit pas entraîner une perte de chance d’être dépisté à temps pour ceux qui en ont besoin.
Diagnostic morphologique :
IRM prostate : Le diagnostic a été très amélioré par l’IRM prostatique, réalisée dans un centre de radiologie avec ses radiologues formés et experts en uro-radiologie. Cette IRM, réalisée avant les biopsies, permet de guider les prélèvements, en estimant de façon précise la présence ou non de cancer de prostate.
Le bilan d’extension doit permettre de préciser la présence de lésions métastatiques. La scintigraphie osseuse recherche les localisations osseuses.
Le scanner et l’IRM explorent les éventuelles localisations ganglionnaires pelviennes et abdominales.
En fonction du stade et du grade cellulaire (score de Gleason), on détermine une classification des différents types de tumeur. Cette détermination permet d’établir un traitement personnalisé qui variera selon que l’atteinte est limitée à la prostate (intra-capsulaire) ou qu’elle a déjà disséminée (extension ganglionnaire et métastases).
Il peut se présenter sous la forme d’une tumeur localisée (circonscrite à la prostate) ou sous une forme évoluée, avec des métastases ganglionnaires et osseuses. La prostate est une glande hormono-dépendante comme le sein chez la femme. Tous n’ont pas le même degré de gravité. 80 % sont découverts à un stade de début, localisé. Ceci incite à encourager le dépistage après 50 ans.
Diagnostic histologiques : Les biopsies prostatiques :
La preuve diagnostique est apportée par l’histologie après biopsie prostatique. Cet examen se fait sous anesthésie locale ou générale et permet d’analyser des fragments de prostate prélevés sous contrôle échographique. Elle succède au diagnostic clinique (toucher rectal) et biologique (dosage du PSA).
L’histologie permet de confirmer la présence d’une tumeur maligne et, en fonction du grade (score de Gleason), de différencier les tumeurs plus ou moins agressives. Le score de Gleason classe les différences de la cellule cancéreuse par rapport à la cellule prostatique normale. Plus la différence est importante et plus le score se rapproche de 10.
On peut y adjoindre l’imagerie (IRM) qui apporte des éléments prédictifs concernant l’atteinte capsulaire et des vésicules séminales.
Traitement
Il varie en fonction de la gravité de la tumeur (classification TNM), selon que le cancer est localisé ou métastatique, selon le volume tumoral et l’espérance de vie du patient. On sait en effet que dans bon nombre de cas, une tumeur prostatique connaît une évolution lente qui peut conduire, chez certains patients âgés, à proposer une simple surveillance.
Les traitements sont multiples, chaque méthode a ses bénéfices et ses effets secondaires.
La prostatectomie radicale : C’est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever la prostate et les vésicules séminales, est un traitement indiqué en priorité dans les cas localisés chez les hommes de moins de 65 ans, et comporte des effets secondaires sexuels non négligeables.
La curiethérapie : C’est une technique qui consiste à implanter de façon permanente des grains d’iode radioactif 125 dans la prostate pour détruire la tumeur est aussi une technique proposée aux hommes jeunes mais comporte parfois des effets secondaires d’inflammation.
La radiothérapie : Elle est proposée aux hommes de plus de 70 ans, ou en cas de contre-indication opératoire. Elle consiste après repérage scannographique à délivrer une irradiation localisée à la prostate entre 72 et 76 Grays.
Le traitement s’échelonne sur près de 2 mois. Habituellement bien supporté, il peut être responsable de troubles urinaires par irritation vésicale et troubles digestifs par irritation rectale. La surveillance se fait sur la stabilité du taux de PSA qui reste toujours dosable.
La surveillance active
Elle peut être proposée pour des formes très localisées avec un grade faible de Gleason. Elle nécessite des contrôles trimestriels du PSA et la répétition des biopsies pour s’assurer de l’absence d’évolutivité de la tumeur. Dans ces cas, l’orientation se fait vers un traitement chirurgical ou radiothérapique.
Le choix du traitement qui vous est proposé est toujours difficile. En effet, du fait de la position de la prostate au carrefour de l’appareil urinaire et génital, tout traitement est responsable d’effets secondaires sur ces 2 systèmes. Le bénéfice du traitement peut donc être réduit par la survenue de complications liées à ce traitement.
Votre urologue vous expliquera pour votre cas particulier les avantages et inconvénients de tel ou tel traitement. Le plus souvent, il n’y a pas d’urgence et un temps de réflexion est nécessaire pour prendre une décision.
Après une intervention chirurgicale
Le traitement des troubles sexuels et de l’incontinence urinaire est possible avec une prostatectomie totale pour cancer. Voici deux fiches informatives permettant de répondre aux questions post opératoires :
Cancer de la vessie

Signes cliniques
Le signe principal est représenté par la présence de sang dans vos urines (hématurie macroscopique). L’hématurie est totale en cas de saignement important ou terminale (dernières gouttes de la miction) en cas de saignements modérés ou répétitifs.
Les signes d’irritation vésicale sont dominés par des envies impérieuses d’uriner (urgenturie, pollakiurie, infection urinaire) qui traduisent l’agression de la paroi vésicale.
Rarement, des douleurs rénales en rapport avec une obstruction des canaux urétéraux est présente et traduit une forme grave.
Diagnostic
Les premiers examens combinent une analyse d’urine (ECBU) pour confirmer et quantifier le saignement, une analyse d’urine à la recherche de cellules anormales (cytologie urinaire ou examen anatomopathologique du sédiment urinaire)et éliminer une infection urinaire et une échographie vésicale qui montre une déformation de la paroi vésicale sous forme d’une lésion bourgeonnante.
La fibroscopie vésicale effectuée au moyen d’un endoscope pourvu d’une caméra examine la paroi vésicale et permet de confirmer la présence de la tumeur vésicale. Il s’agit d’un examen peu douloureux, effectué sous anesthésie locale réalisable au cours d’une consultation.
Si l’image échographique est évidente, l’endoscopie est réalisée sous anesthésie générale afin de réaliser dans le même temps la résection de la tumeur.
Traitement endoscopique
La présence d’un polype impose son ablation (ou résection) après que l’on se soit assuré de la stérilité des urines grâce à l’ECBU. Cette intervention s’effectue sous anesthésie générale ou rachi anesthésie. Un appareil résecteur endoscopique explore et découpe le polype jusqu’à sa base pour en assurer l’ablation complète. Son extraction est assurée par seringage de la vessie. Une sonde vésicale est mise en place pour 48 heures. L’hospitalisation dure entre 2 et 3 jours, temps de cicatrisation de la paroi vésicale. Les modalités de l’intervention et les suites sont comparables à la résection endoscopique de l’adénome de prostate.
Le polype sera ensuite confié au laboratoire d’anatomopathologie qui, après examen microscopique, déterminera le degré d’infiltration et l’agressivité des cellules (grade). Les résultats orienteront le traitement. On distingue 3 cas de figures :
-Un polype non infiltrant et de bas grade justifiera d’une simple surveillance par cystoscopie à 3, 6 mois et 12 mois ou par échographie annuelle en l’absence de récidive.
-Un polype micro infiltrant de grade élevé ou la présence de nombreux polypes justifiera un traitement complémentaire par instillation endovésicale.
-Un polype cancéreux ou infiltrant justifiera d’un bilan complémentaire (scanner et scintigraphie) et d’une chirurgie d’exérèse totale de la vessie.
Traitement par instillation endovésicale
Elle repose sur une série d’instillations vésicales d’agents pharmacologiques afin de diminuer les risques de récidive de tumeur : bacilles de Calmette et Guérin atténués (BCG) ou de mitomycine C (Amétycine) programmées à intervalles réguliers.
Ces instillations débutent 2 mois après la résection du polype. Elles s’effectuent au cabinet de façon hebdomadaire pendant 6 (BCG) ou 8 semaines (Mitomycine). En consultation, l’urologue introduit, à l’aide d’une sonde vésicale le produit préparé à chaque séance. Au retrait de la sonde, vous devez garder le produit dans la vessie pendant au moins 1 heure. Un traitement antibiotique prophylactique est systématique à chaque instillation.
Dans certains cas, votre urologue peut poser l’indication d’une 1ère instillation immédiatement après la résection.
Habituellement bien tolérées, ces instillations peuvent être responsables d’effets indésirables: essentiellement brûlures urinaires, envies fréquentes d’uriner, fièvre, fatigue. Votre urologue adaptera le traitement de ces effets indésirables en fonction de leur gravité. Parfois ces effets secondaires peuvent contre-indiquer la poursuite des instillations.
Surveillance des formes micro infiltrantes
Les instillations endovésicales sont destinées à diminuer les risques de récidive.
La surveillance passe par des contrôles réguliers, mais toute survenue d’épisodes hématuriques au cours de la surveillance doit vous faire consulter plus rapidement pour rechercher une éventuelle récidive. La surveillance repose sur l’échographie et la fibroscopie. Elle peut être associée à la cytologie urinaire.
En effet, il faut procéder à l’ablation de toute récidive découverte à l’occasion des contrôles afin d’en éviter la croissance. En effet les récidives peuvent survenir sur un mode plus agressif que la tumeur primaire, ce qui est désigné sous le terme de « progression ».
La surveillance s’effectue sur de nombreuses années puisque le risque de récidive peut survenir longtemps après l’épisode initial. L’arrêt du tabac est fortement conseillé pour limiter ce risque.
Traitement des formes micro infiltrantes
BILAN COMPLÉMENTAIRE
Le bilan repose sur des examens visant à rechercher des métastases. Le scanner explore l’abdomen et le thorax (métastases pulmonaires, hépatiques et ganglionnaires). La scintigraphie osseuse recherche les localisations osseuses.
D’autres examens peuvent être requis en cas de doute (IRM, Pet scan).
On distingue les formes localisées à la vessie qui nécessitent une chirurgie d’exérèse des formes métastatiques qui requièrent une chimiothérapie.
TRAITEMENT CHIRURGICAL
C’est l’ablation de la vessie : cystectomie. Cette chirurgie lourde nécessite un bilan pré opératoire complet (anesthésique, cardiologique et nutritionnel) pour réaliser cette intervention dans les meilleures conditions.
L’intervention consiste en l’ablation de la vessie et la prostate chez l’homme, la vessie et les organes génitaux internes chez la femme.
Les urines sont ensuite soit déviées dans une dérivation à la peau (stomie urinaire), soit stockées dans un nouveau réservoir vésical (néo vessie) reconstitué à partir de l’intestin grêle.
L’hospitalisation dure une quinzaine de jours et la rééducation 1 à 2 mois.
TRAITEMENT CHIMIOTHÉRAPIQUE
Après mise en place d’un cathéter central (site implantable), les injections de produits chimiothérapiques s’effectuent régulièrement selon des protocoles établis. La toxicité de ces produits est connue et doit être anticipée pour éviter tout effet nocif.
PRONOSTIC
Le pronostic est lié à l’agressivité de la tumeur, essentiellement la profondeur d’infiltration de la paroi vésicale (stade) et l’aspect au microscope de la cellule (grade).
Les petits polypes sont « guéris » par la résection vésicale au prix d’une surveillance régulière.
Pour les polypes intermédiaires, la survie est excellente pour les tumeurs n’envahissant pas le muscle (supérieure à 90 % à 5 ans). Cependant une tumeur peu agressive lors de sa découverte peut le devenir ultérieurement (progression).
Pour les tumeurs cancéreuses de vessie, le pronostic est beaucoup plus réservé et dépend de l’extension locale et régionale de la tumeur.
Cancer du testicule

Diagnostic
Il peut être effectué simplement à partir de l’autopalpation testiculaire qui retrouve une anomalie de consistance de la glande qui semble le siège d’une induration suspecte.
Autrefois, les visites d’incorporation lors du service national ou les visites médicales professionnelles étaient une circonstance classique de découverte de ce cancer chez le jeune. On peut regretter l’insuffisance de sensibilisation et d’information dispensée à l’occasion des visites scolaires autour de cet examen particulièrement simple à réaliser. En cas de difficulté diagnostique, une échographie associée à un Doppler couleur est l’examen de référence pour compléter les données de l’examen clinique.
Certains marqueurs sanguins s’avèrent spécifiques de ces tumeurs germinales comme l’alpha-foeto-protéine et l’hormone gonadotrophique chorionique (HCG). Ils confirment le diagnostic et leur élévation peut constituer un facteur pronostique en fonction de leur taux initial et un élément de surveillance de l’efficacité thérapeutique. Bien que moins spécifique, la lactate-déshydrogénase (LDH) est également prise en compte comme facteur pronostique.
Prise en charge
L’ablation de la glande testiculaire (orchidectomie) constitue la première étape diagnostique et thérapeutique. Une prothèse testiculaire peut être mise en place lors de cette intervention à la demande du patient. Il est recommandé d’effectuer avant le geste chirurgical une conservation de sperme dans une banque du sperme (CECOS) en raison des conséquences possibles de certains traitements sur la spermatogénèse (production de spermatozoïdes).
Cette intervention ne retentit pas sur la sexualité. L’analyse histologique de la tumeur et l’étude du caractère localisé ou non de la tumeur (scanner thoraco-abdominal) orienteront le traitement complémentaire éventuellement nécessaire.
S’il s’agit d’une tumeur localisée à la glande, il pourra en fonction du type cellulaire reposer sur une radiothérapie abdominale, une chimiothérapie ou un curage ganglionnaire rétropéritonéal, voire une simple surveillance.
Les formes avancées avec diffusion de la maladie aux ganglions de l’abdomen voire à d’autres organes justifient des cycles de chimiothérapie adaptés à l’importance de cette diffusion et au taux des marqueurs tumoraux.
À l’issue de cette chimiothérapie, une chirurgie des masses résiduelles ganglionnaires ou métastatiques est parfois nécessaire.
Dans les rares cas de tumeurs bilatérales, qu’elles surviennent simultanément ou secondairement, ou en présence d’un testicule unique d’autre origine, une orchidectomie partielle peut être envisagée pour les tumeurs de petite taille vues précocement.
Surveillance
La majorité des patients est actuellement guérie à l’issue de ces traitements, une surveillance régulière des marqueurs tumoraux et la réalisation de scanners de contrôle s’avèrent néanmoins nécessaires.
Les séquelles éventuelles sont liées aux effets secondaires des différentes thérapeutiques utilisées.
L’autopalpation du testicule restant est conseillée après traitement d’une tumeur testiculaire.
Spécificité
L’approche multidisciplinaire de cette tumeur associant l’urologue, l’anatomopathologiste et l’oncologue permet d’optimiser les attitudes thérapeutiques en assurant une excellente efficacité pour des indications actuellement bien ciblées.
Les stades pathologiques
Ils reposent sur les données d’une classification TNM remise régulièrement à jour. La dernière datant de 2009 distingue le stade T correspondant à l’extension locale de la tumeur avec quatre stades, le stade N correspondant à la diffusion ganglionnaire rétropéritonéale avec trois stades, le stade M correspondant à l’extension métastatique aux différents organes et s’ajoute le S correspondant au taux des marqueurs spécifiques.
Soins de support

Pourquoi avoir recours aux soins de support ?
- Le traitement du cancer n’est pas qu’un traitement chirurgical ou thérapeutique. Les soins de support sont une partie intégrante du traitement et du parcours de soins.
- Le service de soins de support est composé d’une équipe pluridisciplinaire mise à disposition pour accompagner selon les besoins. Il est composé d’un médecin, de diététiciennes, de psychologues, d’une infirmière.
- Plusieurs parcours sont proposés : en amont et en aval de la chirurgie mais aussi de l’ETP (éducation thérapeutique du patient).
Le Programme d'éducation thérapeutique :
Le programme d’Education Thérapeutique du Patient vise à aider les patients diagnostiqués de cancer en attente de traitement ou non ainsi que leurs proches à connaitre et appréhender la maladie, pour améliorer leur qualité de vie avant, pendant quand cela est possible, et surtout après traitement, dans un contexte où l’après cancer peut être source de difficultés et d’errance tant pour le patient et ses proches.
L’enjeu est de permettre au patient d’acquérir de nouvelles compétences répondant à ses besoins médico-psycho-sociaux et à son environnement. Celles-ci concernent en priorité la prise en charge de la douleur, la prise en charge nutritionnelle avec l’alimentation et le reconditionnement physique après traitement, mais également le soutien psychologique pour permettre l’expression des angoisses, des peurs et des besoins et ainsi se reconstruire après cette épreuve
Ainsi les objectifs de ce programme sont :
- D’améliorer la prise en compte de l’ensemble des besoins du patient durant son parcours tout en favorisant son autonomie :
- Avec l’acquisition des connaissances concernant sa maladie et les traitements
- La reconnaissance et la gestion des effets secondaires du traitement
- Assurer la continuité de la prise en charge en soins de support en particulier lors du retour à domicile après les traitements
- Avec une approche multidisciplinaire : physique, psychique, sociale…
- De contribuer à améliorer la qualité de vie du patient et son entourage.
- Par la reconnaissance des signes d’alerte
- Par l’identification des professionnels pouvant l’aider dans les différentes démarches en cas de besoin.
- Par la possibilité d’échanger avec d'autres patients durant les séances, et de ne plus être seul(e ) face à la maladie.
Prévention :
Depuis 2021, avec le soutien de l’ARS , nous avons mis en place une solution mobile de prévention à l’aide d’un bus de prévention nommé l’Hos’CARE tour. Cet outil nous permet de développer des approches de type « aller vers » sur les territoires d’implantation de nos établissements. L’objectif est de faire de la prévention en dehors de nos murs ciblés sur les territoires spécifiques pour aller toucher les personnes au plus près de chez eux via les maisons de santé, les supermarchés, les centres villes dans les zones prioritaires et/ou n’étant pas à proximité d’un établissement de santé. Une équipe de professionnels formés sillonne le territoire pour sensibiliser aux différents facteurs de risque et aux modalités existantes de dépistages organisés.